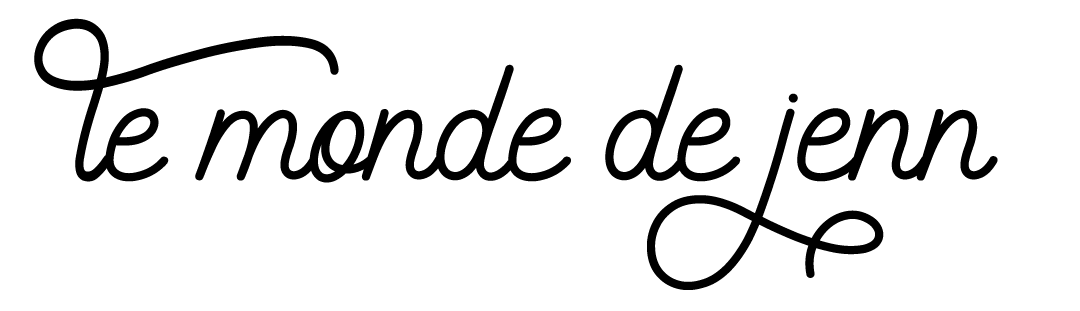L’école, lieu d’instruction ou de formatage ?
Il fut un temps où l’école avait pour mission de transmettre le savoir, d’éveiller la curiosité, de nourrir la réflexion. Aujourd’hui, elle semble davantage préoccupée par la conformité que par l’épanouissement. L’école n’instruit plus : elle forme, modèle, et trop souvent, elle formate.
Dès les premières années, on demande à l’enfant de s’adapter à un moule bien précis. Il doit apprendre à rester assis, à écouter sans broncher, à faire ce qu’on attend de lui, dans l’ordre et sans débordement. Ce n’est pas tant ce qu’il apprend qui est important, mais la manière dont il se conforme. L’école prépare-t-elle encore à penser, ou simplement à obéir ?
Et ce terme d’“Éducation nationale”, n’est-il pas déjà un non-sens en soi ? Car l’éducation, celle qui forme un être humain dans ses valeurs, ses émotions, son identité, n’est pas censée être du ressort de l’État, mais bien de la famille. Ce que l’institution devrait offrir, c’est l’instruction, la transmission des savoirs. Et pourtant, elle prend bien souvent la place des parents sans en avoir ni la légitimité, ni la sensibilité.
“
Ce qu’on appelle ici “apprentissage”, n’est souvent que dressage déguisé. On veut des enfants obéissants, calmes, efficaces.
- Jenn
Dès la maternelle : un rythme qui trahit les besoins de l’enfant
À trois ans, un enfant a besoin de courir, d’explorer, de créer, de rêver. Mais que lui propose-t-on dès son entrée à l’école ? Une chaise. Un emploi du temps. Des ateliers de découpage, de collage, de traçage. Une vie bien droite, bien rangée, bien tranquille… comme on attendra de lui qu’elle le soit plus tard.
Très tôt, on lui apprend à “se tenir”. À ne pas bouger. À ne pas déranger. On fait taire ses élans, ses besoins de mouvement, son imagination débordante. Et on applaudit s’il découpe bien, s’il trace sans dépasser, s’il colorie “comme il faut”. Tout est codifié, évalué, comparé. Et gare à celui qui ose sortir du cadre.
Ce qu’on appelle ici “apprentissage”, n’est souvent que dressage déguisé. On veut des enfants obéissants, calmes, efficaces. Des futurs élèves modèles, avant même d’être des petits êtres épanouis. Et à force de prioriser la discipline sur la découverte, on finit par tuer dans l’œuf cette étincelle naturelle qu’est la curiosité.

Des enfants étiquetés et enfermés dans des cases
Très vite, les enfants sont jugés. Comparés. Rangés dans des catégories aux contours flous mais aux conséquences bien réelles. Celui-ci “a du mal à se concentrer”, celui-là “manque de maturité”, un autre “ne tient pas assis”. Et cela commence dès la maternelle. Avant même qu’ils aient eu le temps de se découvrir eux-mêmes, l’école leur colle une étiquette sur le front.
Les attendus sont normés, identiques pour tous, sans égard pour les personnalités, les rythmes, les histoires. Si un enfant ne sait pas découper droit, écrire son prénom, ou répondre correctement à une consigne à quatre ans, il est en “retard”. Retard sur quoi ? Sur une ligne de départ décidée arbitrairement, sans nuance ni respect du développement individuel.
Cette obsession de la norme conduit à une chose : l’oubli de l’enfant derrière l’élève. On attend qu’il entre dans les cases, quitte à le faire de force. Mais certains enfants n’entreront jamais dans ces cases – et c’est tant mieux. Sauf que le système ne le voit pas ainsi. Il considère la différence comme un problème à corriger. Et peu à peu, ces enfants finissent par croire qu’ils sont “nuls”, “agités”, “pas comme il faut”. On ne les aide pas à se connaître, on les aide à se conformer.
“
Le système considère la différence comme un problème à corriger.
- Jenn
Une instruction appauvrie et une réussite factice
Pendant ce temps, que leur apprend-on vraiment ? Trop souvent, pas grand-chose. Ou du moins, pas assez. Et surtout, pas de manière durable. Les fondamentaux – lire, écrire, compter – sont fragiles, approximatifs, parfois totalement absents chez certains élèves qui franchissent pourtant les classes les unes après les autres.
Les évaluations sont allégées, les exigences baissées, les seuils de réussite ajustés… non pas pour accompagner les élèves en difficulté, mais pour masquer la réalité. On ne rehausse plus le niveau des enfants, on abaisse celui des attentes. Résultat : une réussite artificielle, construite sur des notes gonflées, des bulletins flatteurs, des compétences validées à moitié.
Et tant que les enfants “réussissent” sur le papier, tout va bien. Peu importe qu’ils ne sachent pas réellement lire un texte avec fluidité, comprendre un énoncé, ou faire une opération simple sans calculette. L’important, c’est qu’ils avancent, qu’ils rentrent dans les quotas, qu’ils valident leur passage. Mais à quel prix ?
En réalité, on leur offre une fausse image d’eux-mêmes. On leur apprend qu’ils n’ont pas besoin d’effort pour réussir, qu’on s’adaptera toujours à leur niveau. On leur ment. Et ce mensonge-là est peut-être le plus grand échec du système.

“
On ne les aide pas à se connaître, on les aide à se conformer.
- Jenn
Des professeurs isolés, des parents désorientés
Dans cette école en perte de sens, les professeurs sont souvent les premiers témoins du naufrage. Ils voient, chaque jour, les lacunes qui s’accumulent, les enfants qui peinent à suivre, les rythmes qu’on impose sans ménagement. Ils savent. Mais peuvent-ils encore parler librement ?
Aujourd’hui, beaucoup de professeurs se taisent pour ne pas avoir de problèmes. Ils n’osent plus dire à un parent que son enfant ne sait pas lire correctement, qu’il présente des fragilités, ou qu’il aurait besoin d’un accompagnement plus adapté. Pourquoi ? Parce que trop souvent, la réaction est hostile. Les familles ne veulent pas entendre ce qui dérange leur idéal. Il ne faut surtout pas bousculer l’image du petit génie qu’ils croient avoir à la maison.
Une remarque pourtant fondée peut vite se transformer en conflit. Le professeur devient l’ennemi, l’accusé, celui qui “ne comprend pas l’enfant”, qui “ne sait pas enseigner”, voire celui qu’on menace de signaler à la direction ou à l’inspection. Alors ils se taisent. Et ils valident à contrecœur des acquis qu’ils savent incomplets. Ils remplissent des bulletins bienveillants mais mensongers. Ils avancent, contraints, dans un système qui leur interdit la vérité.
Et pendant ce temps, le lien avec les parents se délite. Il n’y a plus de collaboration, plus d’écoute mutuelle, plus de volonté de cheminer ensemble pour l’enfant. Chacun reste campé sur sa position. L’école fait semblant de transmettre, les parents font semblant d’y croire. Mais l’enfant, lui, avance sur une base de plus en plus fragile.
L’enfant performant… mais trop libre pour être valorisé
L’école devrait être un lieu où l’on encourage chaque élève à avancer à sa manière, selon ses talents, ses intuitions, ses logiques. Mais aujourd’hui, même un enfant qui réussit “trop bien” peut poser problème. Pourquoi ? Parce qu’il ne suit pas la méthode attendue.
Si l’enfant trouve la bonne réponse par une voie différente, s’il contourne la procédure imposée, s’il comprend sans passer par les étapes minutieusement décrites dans le manuel, alors son raisonnement est invalidé. On lui dira qu’il a “mal fait”, “pas comme il faut”. Peu importe le résultat, seule la méthode compte. Mais comment ne pas y voir une volonté de formatage, là encore ?
On ne veut plus d’enfants créatifs, autonomes, qui développent une pensée personnelle. On veut des élèves obéissants, reproducteurs, conformes. Des enfants qui apprennent à faire ce qu’on leur demande, pas à penser.
“
On ne veut plus d’enfants créatifs, autonomes, qui développent une pensée personnelle. On veut des élèves obéissants, reproducteurs, conformes.
- Jenn
Une génération entière “à troubles” ?
Autre phénomène troublant : la multiplication des diagnostics et des troubles associés aux enfants. Il ne se passe plus une rentrée sans qu’on entende parler de dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, TDAH, haut potentiel, hypersensibilité… Au point qu’on peut se demander : que se passe-t-il réellement avec cette génération ? Sont-ils vraiment plus nombreux à être porteurs de troubles, ou bien le système a-t-il déplacé le problème sur leurs épaules ?
Autrefois, les enfants dits “remuants”, “dans la lune” ou “en difficulté” n’étaient pas systématiquement étiquetés. On leur demandait des efforts, on les reprenait, on les accompagnait tant bien que mal. Aujourd’hui, dès qu’un enfant sort un peu des clous, il est orienté vers une batterie de bilans pour déterminer ce qui ne va pas chez lui. Mais est-ce vraiment l’enfant qui dysfonctionne ? Ou bien est-ce l’école qui ne sait plus s’adapter à la diversité des profils ?
À force de vouloir faire entrer tous les enfants dans un moule rigide, il est normal que certains cassent. Et quand ils cassent, au lieu de remettre en question le moule, on leur colle une étiquette.
Ce recours quasi systématique au diagnostic pose une autre question : n’est-ce pas une manière de déresponsabiliser l’institution ? Plutôt que de remettre en question la pédagogie, l’organisation, le rythme scolaire… on fait porter le poids de l’échec à l’enfant lui-même. Et ce faisant, on l’enferme dans un statut de “différent”, voire de “déficient”, alors qu’il aurait peut-être suffi de lui donner un peu plus de temps, d’écoute, de souplesse.
“
Est-ce vraiment l’enfant qui dysfonctionne ? Ou bien est-ce l’école qui ne sait plus s’adapter à la diversité des profils ?
- Jenn
Des parents trop confiants, parfois peu impliqués
C’est peut-être là que réside une part du problème : les parents ne voient plus ce qu’il se passe réellement à l’école. Pour beaucoup, leur enfant “réussit”. Il a de bonnes notes, des appréciations encourageantes, un passage de classe validé. Alors pourquoi s’inquiéter ?
Mais ce que l’on ne leur dit pas, c’est que le niveau d’exigence a été largement abaissé. Ce qu’on demande aujourd’hui à un élève de CM2, c’est ce qu’on attendait autrefois d’un CE2. Le socle commun de connaissances s’est rétréci, vidé de sa rigueur. Pourtant, peu de parents prennent le temps de regarder de plus près les devoirs, les évaluations, les contenus. Peu se demandent : “Qu’apprend réellement mon enfant ? Est-ce suffisant pour qu’il comprenne, pour qu’il pense, pour qu’il progresse ?”
Certains sont convaincus que “l’école sait ce qu’elle fait”. D’autres se déchargent, consciemment ou non, de toute responsabilité éducative. Mais instruire un enfant ne peut pas reposer uniquement sur une institution fragilisée. Cela demande une vigilance, un engagement, une présence parentale active.
Car un enfant ne peut pas avancer seul. Et encore moins dans un système qui fausse les repères. S’il n’a pas un adulte à ses côtés pour l’encourager, l’accompagner, remettre du sens, il risque de grandir avec une confiance artificielle… qui s’effondrera tôt ou tard face aux réalités du monde.
Pour conclure
l est temps de regarder la réalité en face : notre système scolaire est en crise. N’est-ce pas voulu ? Pour faire de ces enfants des adultes plus dociles, moins enclins à questionner, à s’émanciper, à penser par eux-mêmes ?
Ce n’est pas seulement une question de méthodes ou de programmes, c’est une question de respect de l’enfant, de ses rythmes, de sa singularité. Tant que l’école cherchera à formater plutôt qu’à éveiller, à uniformiser plutôt qu’à valoriser les différences, elle continuera d’affaiblir nos enfants au lieu de les construire.
Mais ce constat n’est pas une fatalité. Nous, parents, enseignants, citoyens, avons le pouvoir — et le devoir — de demander une école à la hauteur de nos ambitions pour nos enfants. Une école qui les encourage à penser par eux-mêmes, à explorer, à prendre confiance dans leurs capacités, plutôt qu’à se conformer à un modèle rigide et dépassé.
Cela passe par un dialogue sincère et renouvelé entre familles et enseignants, par un vrai respect des rythmes de chaque enfant, par une pédagogie qui valorise l’effort et la créativité, et par des exigences réelles qui poussent à se dépasser plutôt qu’à se satisfaire du minimum.
Changer l’école, c’est un défi collectif. Mais c’est aussi un espoir immense : celui d’une génération capable non seulement de réussir scolairement, mais surtout d’être pleinement elle-même, avec confiance et curiosité.
Alors, si nous voulons vraiment préparer nos enfants à demain, il est urgent d’agir. Pour eux. Pour nous. Pour l’avenir.
Photographies : kaboompics
Pas de collaboration sur cet article